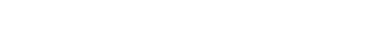Le 12 décembre 2024, la Cour de cassation a jugé conformes les demandes de référendum déposées en juillet par la CGIL concernant, entre autres, la réglementation des licenciements illégaux dans le cadre du contrat de travail dit de « protection croissante » en application du décret législatif 23/2015.
Ce système correctif a toujours intéressé l’opinion publique et le débat politique, et représente toujours un point de fracture entre les partenaires sociaux. Il suffit de rappeler que si, le 8 septembre 2024, lors de la première rencontre publique entre le leader de la CGIL, Maurizio Landini, et le président de la Confindustria, Emanuele Orsini, ce dernier avait confirmé que « surmonter le Jobs act serait un plongeon dans le passé, nous avons un écart entre l’offre et la demande de travail qui représente 43 milliards par an. Pour nous, la question aujourd’hui est d’attirer les gens, pas de surmonter une mesure qui fonctionne ». D’autre part, le secrétaire général de la CGIL a déclaré qu’avec le feu vert de la Cassation aux questions du référendum, “une grande opportunité s’ouvre pour le pays”.

Compte tenu de l’écart persistant entre les positions des partenaires sociaux et du fort impact que le contrat à protection croissante a sur l’opinion publique (la preuve en est, tout récemment, l’obtention du quorum référendaire), il semble utile d’évaluer si, d’un simple point de vue technico-juridique la législation prévue par le décret législatif 23/2015 présente actuellement des différences substantielles par rapport à la protection offerte par l’article 18 du Statut des travailleurs, tel que modifié par la loi 92/2012, au point de rendre son abrogation indispensable – de l’avis des partisans du référendum – en vue d’étendre le champ d’application de la protection de la réintégration.
Dans sa formulation originale, l’intervention du législateur se caractérisait par la détermination automatique de l’indemnité due en cas de licenciement illégal, sur la base d’une formule mathématique, afin de surmonter un système reposant sur l’appréciation de l’organe de jugement.
Continuer la lecture de la version complète publiée dans Il Sole 24 Ore.